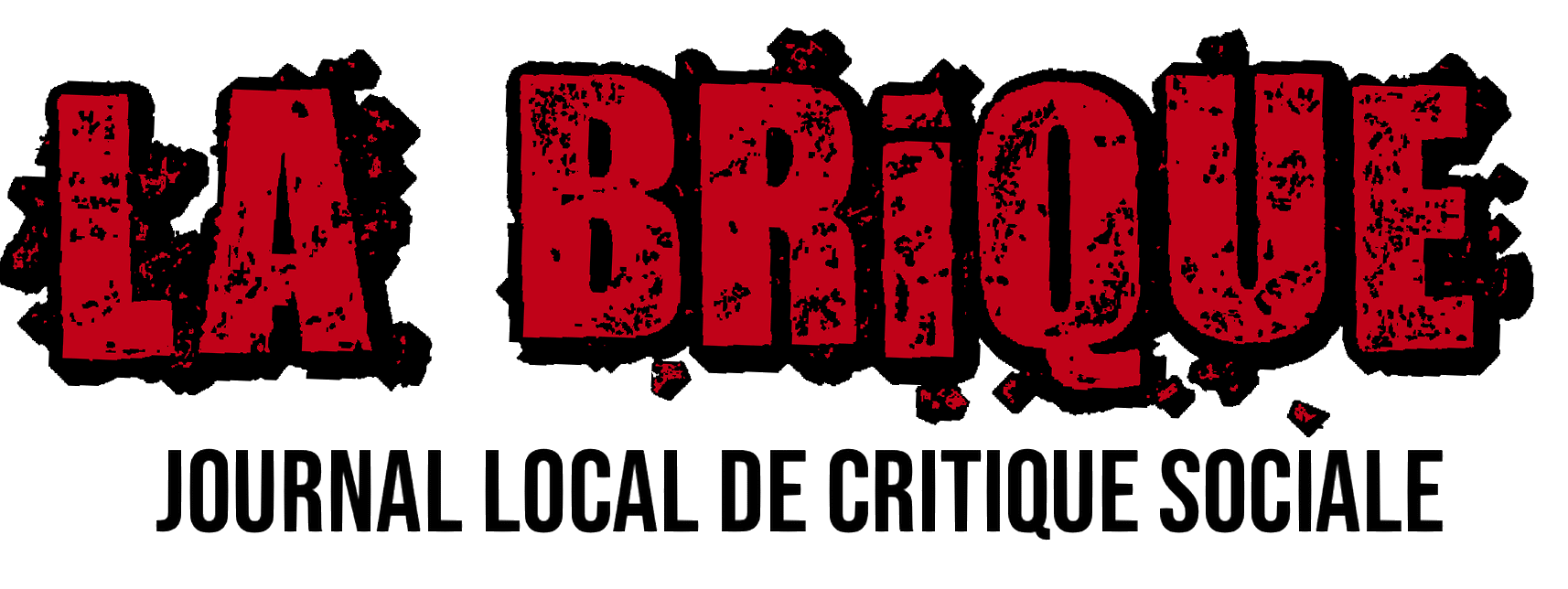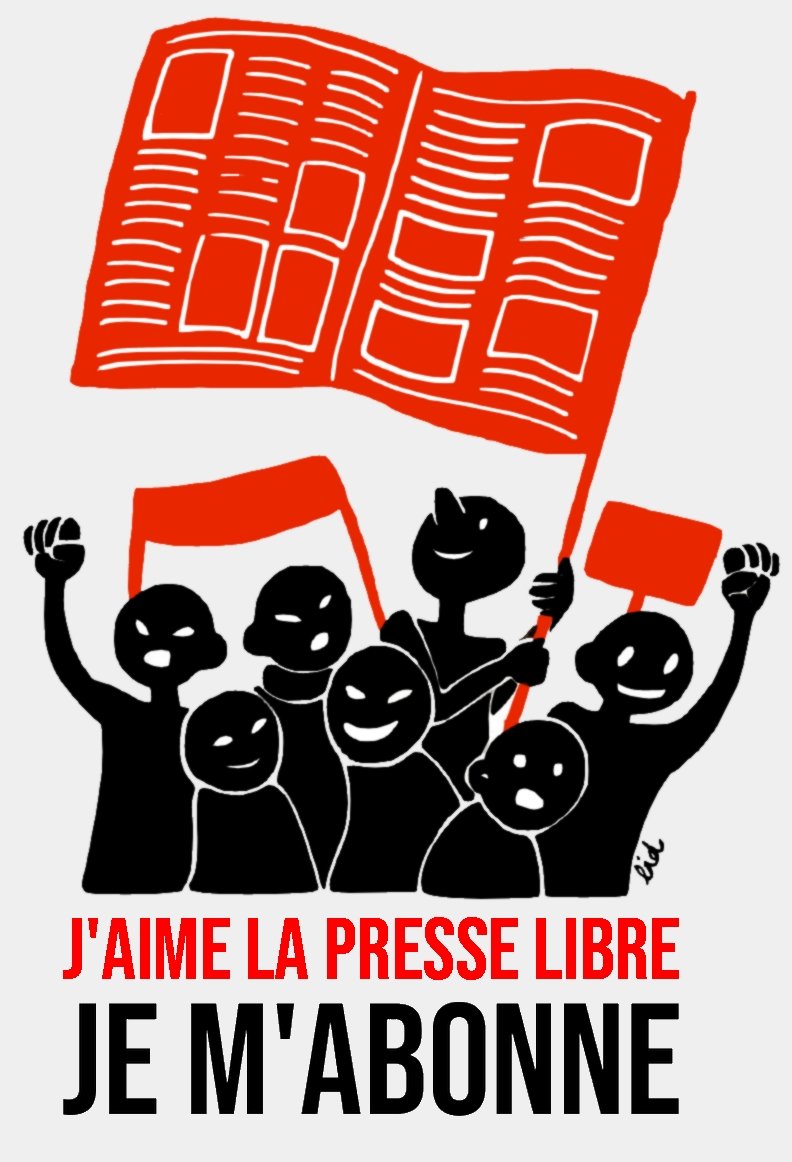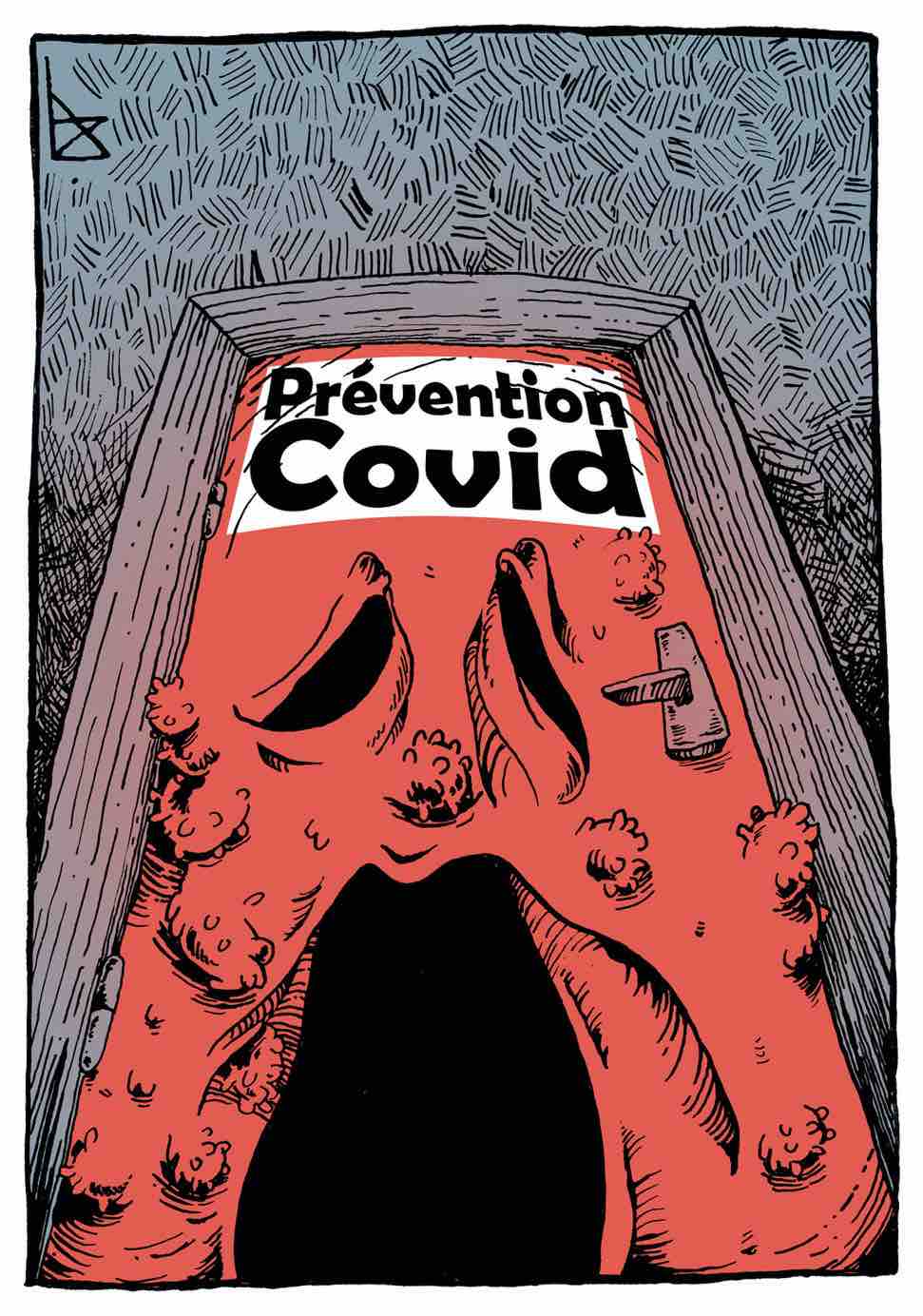 Si l’hécatombe attendue dans les EHPAD1 n’a pas eu lieu, la situation est demeurée opaque. La Brique revient un peu en arrière en interrogeant Nathalie, qui officiait en tant que stagiaire aide-soignante en EHPAD au début du confinement.
Si l’hécatombe attendue dans les EHPAD1 n’a pas eu lieu, la situation est demeurée opaque. La Brique revient un peu en arrière en interrogeant Nathalie, qui officiait en tant que stagiaire aide-soignante en EHPAD au début du confinement.
Pour Nathalie*, le début de son stage ne fut pas sans une certaine inquiétude, vite combattue : « si je fais une formation pour être aide-soignante et que je me retire dès qu’un virus circule, cela n’a pas de sens ».
L’établissement où Nathalie arrive en
début de crise avait déjà pris quelques précau-tions : « les visites étaient déjà interdites à mon arrivée ». Mais les résident.es continuaient à vivre comme à l’ordinaire à l’intérieur de l’établissement: « les repas étaient pris en commun, les animations et les activités de groupe avaient toujours lieu et les déplacements demeuraient libres ».
Vite, Nathalie s’interroge : « la question que je me suis posée à un moment donné, était de savoir jusqu’où l’on prenait le risque d’être contaminé.es par les résident.es ou l’inverse. Certain.es étaient déjà malades, était il plausible que ce soit les soignant.es qui les aient contaminé.es ? »
Économies guère salutaires
En début de crise, le manque de communication claire du gouvernement, particulièrement flagrant sur la question des masques, a laissé les Ehpad seuls face à leur responsabilité. Conséquence : le personnel a essuyé les plâtres. « Au début nous n’avions aucune obligation de prendre quelques précautions particulières ». Le port du masque est laissé au « bon vouloir » de chacun.e, « si cela nous rassurait » dans un premier temps. Nathalie observe donc les professionel.les qui l’entourent et en conclut que les masques servent surtout à apaiser les craintes. « Je n’avais pas l’impression que ça servait à grand chose ». Ainsi, elle n’en porte pas pendant quelques jours. Au bout d’une semaine, le discours de la direction change : « il fallait mettre des masques et nous en avons mis ».
À cette même période, certain.es résident.es commencent à montrer des symptômes du COVID 19.
Les masques sont alors distribués de manière rationnée : « les masques chirurgicaux, on en avait un pour la journée. Par la suite, il fut possible d’en avoir deux pour la journée, sachant que leur efficacité effective s’élève à trois heures, et qu’ils empêchent surtout la soignante de contaminer, non l’inverse ». La distribution de matériel, non-adapté à la situation, est faite au prorata du temps de travail : « celles qui pouvaient bénéficier de deux masques par jour étaient les personnes faisant des journées de 12 heures. Il était donc possible de changer de masque à la mi-journée. Chaque jour, les masques étaient scrupuleusement comptés pour l’équipe de jour et celle de nuit. Il n’était pas question de changer de masque au bout de trois heures. Cela aurait signifié prendre les masques de nos collègues de l’équipe de nuit ».
Branle-bas de combat post-dépistage
Puis les premiers cas deviennent officiels : « nous avons eu des des tests et deux résultats furent positifs. À partir de là, nous avons stoppé les dépistages ». Suite aux résultats, les résident.es sont isolé.es dans leurs chambres et les dépistages… s’arrêtent, faute de tests ! Nathalie confirme qu’« il y a eu des décès », mais pas de dépistages post-mortem à sa connaissance. La circulation de l’information est opaque : « tous les jours les informations étaient différentes, notamment le nombre de personnes sous précautions spécifiques liées au virus ». Souvent, les soignantes n’étaient pas conviées aux réunions.
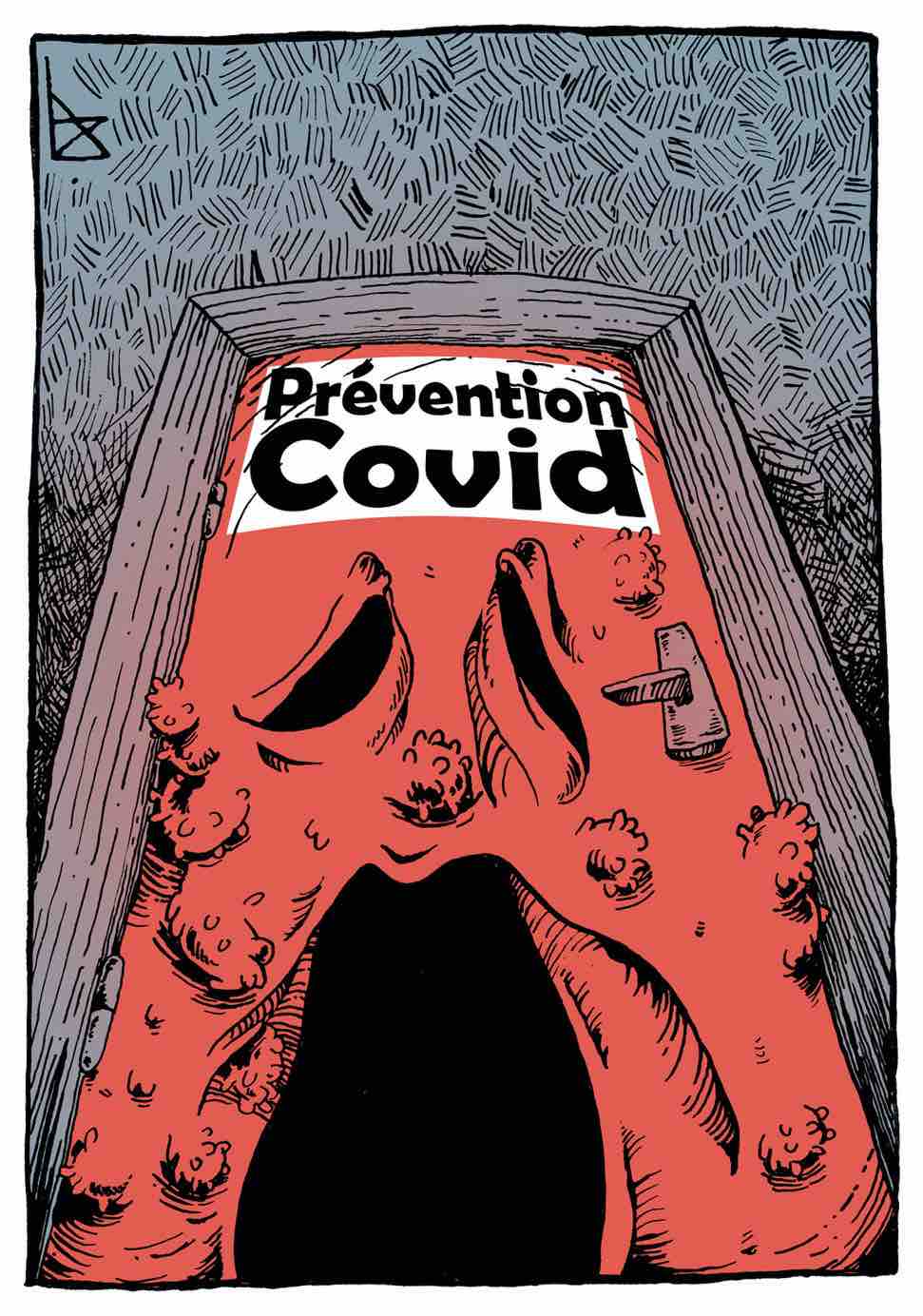
Si une cellule psychologique est mise en place, l’équipe soignante n’y est pas conviée. « Les soignantes qui ont eu des symptômes n’ont pas été dépisté.es ». L’équipe est simplement soumise à un test de température en arrivant et en partant du lieu de travail. « Lorsqu’une fièvre était constatée, on était censées ne plus travailler ». Certaines tensions naissent chez les employées : « j’ai vu des gens revenir d’arrêts maladie, d’autres en partir. J’ai également croisé des personnes convaincues d’avoir été contaminées à un moment donné car les symptômes étaient plutôt évidents ». Des conflits internes naissent et les bruits courent : « untel a peur, alors il s’arrête, mais il n’a rien ». La direction compense la surcharge de travail par le recours aux stagiaires et à des équipes d’autres structures appartenant au même groupe.
Austérité de vie
Au-delà des difficultés d’organisation du travail, l’un des aspects les plus dramatiques de l’EHPAD reste les conditions de vie de ses résident.es, désormais reclu.ses dans leurs chambres. Elles « sont désorienté.es, elles ne comprennent pas la situation, demandent pourquoi elles ne descendent plus pour manger ou ce genre de choses ». Il est compliqué de prendre le temps pour expliquer et rassurer ces personnes. Seul le temps de soin est possible et « les interactions sont extrêmement réduites ». L’établissement tente néanmoins de garder le lien avec les familles, par mail ou vidéo. Mais cela ne comble pas le vide laissé par l’absence des kinésithérapeutes, pédicures et coiffeur.ses… Nathalie s’inquiète : « j’ai vu des personnes tomber dans le syndrome de glissement2, de ne plus avoir envie de rien. »
Les familles s’inquiètent de ce qui se passe au sein de l’établissement, mais obtiennent peu de réponses. « Tout le monde angoissait à l’idée de voir si oui ou non il y avait de nouveaux cas au sein de l’établissement. On n’en parlait pas non plus aux résident.es. C’était délicat, car cela amenait davantage d’anxiété dans un moment où les pensionnaires étaient particulièrement isolé.es, pas loin de l’enfermement finalement. Ils sont comme nous, sauf qu’ils sont plus âgé.es. Ils ont moins de prises avec le réel, ils le subissent davantage, plus que nous. »
Le traitement des malades du COVID19 n’est guère réjouissant. « L’attitude que j’ai pu observer vis-à-vis des personnes contaminé.es m’a rappelé celle qui a eu lieu avec les premières personnes infectées par le VIH. Je trouve qu’il n’y a pas de précautions particulières pour ces personnes. Je ne parle pas de précautions d’hygiène mais de procédés stigmatisants comme placarder sur la porte « précaution COVID ». Les protocoles et procédures de soins sont par ailleurs com-pliquées à mettre en place : « tous les jours ils changeaient ». Limiter la transmisison par contact devient un véritable casse-tête.
En somme la possibilité de soins décents et la qualité de vie des résident.es des EPHAD est tout aussi en péril que pour l’hôpital public et ses malades. Malheureusement, ce constat est devenu poncif et l’urgence une norme à laquelle les travailleur.ses du soin sont obligé.es de se plier.
Le phénomène de population vieillissante a certes obligé le gouvernement à ne plus ignorer ces problématiques, ou tout au moins à déclarer à tout va et comme à son habitude des « plans d’actions »3, il n’empêche que cette pandémie révèle amèrement une situation plus alarmante qu’améliorée.
Sacha Peurh
* le prénom a été modifié, en fait elle s'appelle Cunégonde.
1. Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
2. Syndrome défini par une détérioration rapide de l'état général survenant chez un sujet très âgé au décours d'une affection aiguë ou après un intervalle libre. En l'absence de prise en charge, elle évolue rapidement vers le décès en quelques jours ou semaines (maximum 4 semaines).
3. « Feuille de route pour relever le défi du vieillissement à court et moyen terme » présentée par Agnès Buzyn le 30 mai 2018.