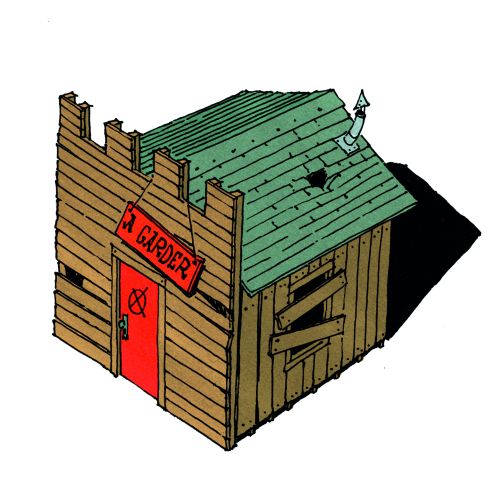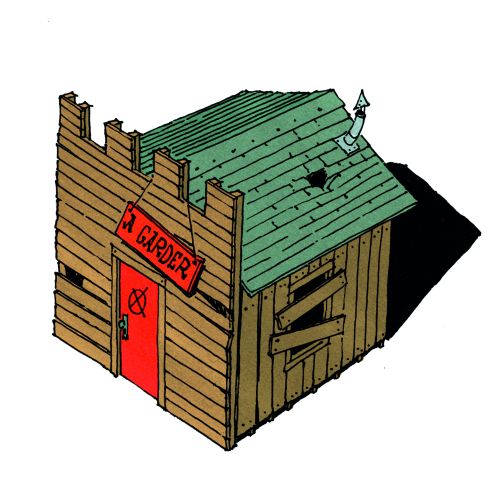 Depuis 2010, il est possible de payer pour crécher sans bénéficier d'un contrat de location en bonne et due forme. Vous ne le saviez pas ? La ministre du logement non plus. Découverte d'un dispositif venu des Pays-Bas et de la multinationale Camelot, « leader européen » de ce nouveau marché de la « gestion et [de] la protection des biens immobiliers vacants », soit une méthode anti-squat. Quand le peuple paie pour garder le château des riches...
Depuis 2010, il est possible de payer pour crécher sans bénéficier d'un contrat de location en bonne et due forme. Vous ne le saviez pas ? La ministre du logement non plus. Découverte d'un dispositif venu des Pays-Bas et de la multinationale Camelot, « leader européen » de ce nouveau marché de la « gestion et [de] la protection des biens immobiliers vacants », soit une méthode anti-squat. Quand le peuple paie pour garder le château des riches...
Camelot, nommée en référence au château du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table ronde, a comme les autres sociétés anti-squat deux objectifs : le premier est d’empêcher que des bâtiments vides ne soient squattés et le second de faire du pognon. Profitant de la pénurie de logements abordables et des difficultés que rencontrent les plus pauvres sur le marché de la location, ces sociétés proposent des contrats iniques d’occupation temporaire de locaux1. Les résident.es assurent en contrepartie un service de gardiennage non-rémunéré et payent en sus une compensation financière qui tombe directement dans l’escarcelle de Camelot. Laquelle compensation, sans atteindre le prix d’un loyer, n’est pas non plus négligeable : il faut débourser 180 euros par mois en moyenne pour un peu de droit au sommeil2 sachant qu’il est possible d’être invité.e à déguerpir en moins de deux semaines. En échange, le propriétaire s’évite les frais d’entretien et de gestion ainsi que la taxe sur les immeubles vacants puisque le bâtiment est effectivement occupé, quand bien même ce serait par un gueux qu’il est possible de déloger sans peine. Les redevances versées par les résident.es, petits ruisseaux de la misère, font au final une grosse rivière capitaliste : pour 2014, Camelot Europe annonçait un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.
Profits pour nous, taudis pour vous
Les bâtiments gérés par les sociétés anti-squat ont vocation à être détruits, vendus ou rénovés et les contrats tiennent le temps que le projet se réalise. En attendant, les frais de maintenance et les réparations sont à la charge des résident.es. Un habitant explique le marché proposé par la société anti-squat dans un appartement destiné à la vente. « Ils m’ont dit : "Vous pouvez avoir cet appartement mais vous devez le nettoyer intégralement, le rendre plus vivable." […] Et quand le contrat sera fini au bout de trois semaines, nous avons d’autres maisons à vous proposer. »
Le contrat anti-squat consiste en une liste d’interdictions et de devoirs à respecter. Le ou la résidente doit bien comprendre que le logement qu’elle occupe n’est pas le sien. Les inspections sans avertissement deviennent un outil pour intimider et punir les résident.es, lesquel.les ont pour obligation de laisser un double des clés à la société. « Nous avions changé les serrures mais nous avons eu des problèmes. » Un couple témoigne du chantage à l’expulsion exercé sur eux. « L’inspecteur nous a intimidé.es et nous a dit : "Si vous ne nous donnez pas les clés, alors vous devrez quitter la maison." »
Appartements, bureaux, garages et pourquoi pas châteaux, tous les types de biens sont concernés, sans obligation de salubrité ni norme d’hygiène ou de sécurité. En 2013, une jeune fille est morte par électrocution à cause d’un système électrique défaillant. La maison dans laquelle elle logeait avait été qualifiée d’« inhabitable » quelques années auparavant par un conseiller municipal. La mairie, propriétaire du bâtiment, en avait transmis la gestion à Camelot.
Irresponsabilité collective
Cette évolution s’inscrit dans le cadre bien connu des politiques de dérégulation des marchés, ici immobilier. Aux Pays-Bas, depuis que l’État a cessé de financer les organismes de logements sociaux dans les années 90, la part de ces logements s’est écroulée pour passer de 43 % à 30 %. Les bailleurs sociaux se sont engagés dans des politiques de privatisation massive pour augmenter leurs recettes. Pour parachever le désastre, l’Union européenne impose de restreindre les logements sociaux aux ménages gagnant moins de 33 000 euros par an. Aujourd’hui, ces organismes sont les principaux clients des sociétés anti-squat. Mais la gamme des propriétaires qui utilisent ce dispositif est très étendue : des collectivités territoriales jusqu’aux institutions financières, tous engraissent Camelot et ses concurrentes. C’est parce que les décideurs politiques et les organismes de logement ont renoncé à soutenir des politiques sociales du logement que les sociétés anti-squat se développent, pouvant apparaître aux personnes en difficulté sur le marché locatif comme les seules solutions de logement. Même si les contrats sont désavantageux et n’offrent aucune protection. Par rapport au marché du logement traditionnel, même social, ces contrats ont l’avantage de fournir un coût moindre, une rapidité d’accès et une surface habitable plus grande. Estimés entre 30 000 et 50 000 aux Pays-Bas actuellement, les résident.es ayant recours à l’anti-squat forment une nouvelle classe de sous-locataires et de mal logé.es en pleine expansion.
Camelot à la française
En France, le dispositif anti-squat fait son chemin. Démarchée par la société Camelot, la ministre du logement Christine Boutin fait adopter en février 20093 une loi qui ouvre la voie aux contrats anti-squat en créant un statut de résident.e temporaire qui permet au marché de fragiliser l’existence des personnes les plus pauvres. Pas très catholique. Aujourd’hui l’état des lieux est très mal connu, entre un peu de désinformation (les meilleurs plans font l’objet de reportages à sensation) et beaucoup d’ignorance sur les effets de cette prime à la précarisation. Interpellée l’an der- nier par l’association Droit au logement (DAL), Emmanuelle Cosse, pourtant ministre du logement, avoue qu’elle ignorait jusqu’à l’existence de cette loi. Un seul indice : la filiale française de Camelot annonce que son chiffre d’affaires a doublé en 2014.
Pour lutter contre le mal-logement, les dettes locatives et les expulsions dont sont responsables la spéculation immobilière et les prix du marché qui s’envolent, on aurait plutôt envie de proposer la taxation à bloc des logements vacants ou la généralisation du squat mais les réacs de tout poil agitent le spectre des occupations illégales. Natacha Bouchart, maire de Calais, co-signe en juin 2014 une proposition de loi dont les attendus ressemblent à un mauvais film : « Les exemples se multiplient de personnes qui, de retour de vacances, d’un déplacement professionnel ou d’un séjour à l’hôpital, ne peuvent plus ni rentrer chez elles, parce que les squatters ont changé les serrures, ni faire expulser ces occupants4. » C’est plus convaincant que de montrer comment des squatteurs retapent des logements laissés à l’abandon pendant dix ans par des proprios qui parient sur la hausse des prix du marché. Dans le royaume Camelot, les riches possèdent les biens immobiliers et s’allient aux politiques. Quant aux pauvres, s’ils veulent dormir au chaud, ils doivent servir les intérêts capitalistes en fermant leur gueule. D’ailleurs, c’est stipulé dans le contrat, les résident.es ne peuvent pas parler à la presse. Nous, on ne pouvait pas se taire.
Aurélie
1. Les chiffres sont tirés d'une étude menée aux Pays-Bas auprès du Bond Precaire Woonvormen, association créée en 2010 et membre de la coalition européenne pour le droit au logement et à la ville, qui s’est fait connaître pour son combat contre les agences anti-squat. Les statistiques et témoignages qui suivent sont tirés d'un échantillon de 215 plaintes déposées par des résident.es auprès de l’association.2. À la redevance s'ajoutent divers frais versés aux sociétés mais qu'elles se gardent bien de communiquer et qui comprennent un kit de sécurité plus ou moins onéreux (45 à 90 euros), des frais d’administration (60 à 90 euros) ainsi que des frais de service.3. Lancelot, filiale française de Camelot, jubile dans un communiqué de presse : « Le gestionnaire de biens inoccupés Camelot a fait adopter un nouveau texte de loi en France et renforce ainsi sa position sur le marché européen. » On dit merci qui ?4. Proposition de loi n° 586, « visant à faciliter l'expulsion des squatteurs de domicile », enregistrée au Sénat le 5 juin 2014.
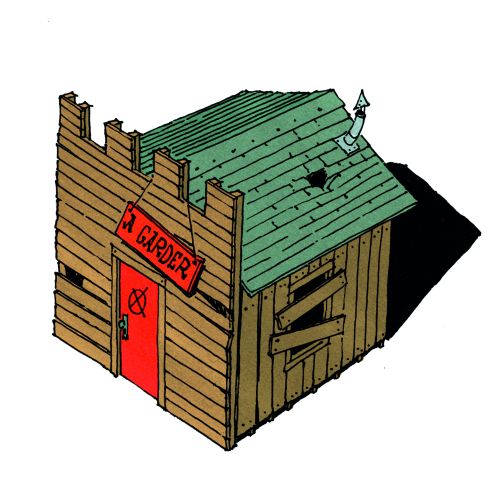 Depuis 2010, il est possible de payer pour crécher sans bénéficier d'un contrat de location en bonne et due forme. Vous ne le saviez pas ? La ministre du logement non plus. Découverte d'un dispositif venu des Pays-Bas et de la multinationale Camelot, « leader européen » de ce nouveau marché de la « gestion et [de] la protection des biens immobiliers vacants », soit une méthode anti-squat. Quand le peuple paie pour garder le château des riches...
Depuis 2010, il est possible de payer pour crécher sans bénéficier d'un contrat de location en bonne et due forme. Vous ne le saviez pas ? La ministre du logement non plus. Découverte d'un dispositif venu des Pays-Bas et de la multinationale Camelot, « leader européen » de ce nouveau marché de la « gestion et [de] la protection des biens immobiliers vacants », soit une méthode anti-squat. Quand le peuple paie pour garder le château des riches...