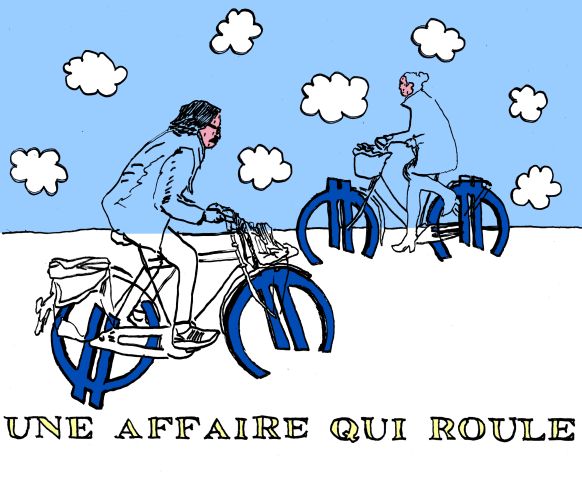 Clément Fontan est chercheur en science politique. Spécialiste de la Banque Centrale Européenne, il critique depuis plusieurs années les gouvernements européens, Frankenstein modernes, créateurs d’un monstre – la banque centrale européenne. Il nous raconte l’histoire de ce colosse « indépendant » dont les actions ne cessent de creuser les inégalités, entre sauvetage des banques, réformes néolibérales et petits arrangements entre amis.
Clément Fontan est chercheur en science politique. Spécialiste de la Banque Centrale Européenne, il critique depuis plusieurs années les gouvernements européens, Frankenstein modernes, créateurs d’un monstre – la banque centrale européenne. Il nous raconte l’histoire de ce colosse « indépendant » dont les actions ne cessent de creuser les inégalités, entre sauvetage des banques, réformes néolibérales et petits arrangements entre amis.
D’où vient cette idée de « banque centrale indépendante » hors de contrôle des gouvernements ?
La création de la banque centrale européenne en 1999 a consacré la domination tout-terrain du modèle de la banque centrale indépendante. Apparues dans leur forme moderne à la fin du XIXe siècle, les banques centrales ont été créées par les États nations pour faire face à un triple défi : imposer une monnaie unique sur le territoire national, financer leur dette et réguler les cycles financiers. En jouant un rôle d’interface entre marchés et gouvernements, les banques centrales sont devenues un acteur crucial de régulation des activités économiques nationales. L’étendue des missions et le degré d’indépendance des banques centrales envers les autorités politiques fluctuent en fonction des idées économiques dominantes et des rapports de forces entre élus et financiers. depuis les années 1980, la diffusion des idées néolibérales et la place de plus en plus centrale des marchés dans le fonctionnement de nos sociétés ont été des facteurs importants dans la diffusion du modèle de la banque centrale indépendante.
La logique intellectuelle de ce modèle est plutôt facile à suivre, tout en étant très contestable : le statut d’indépendance permettrait de renforcer la crédibilité des banques centrales auprès des marchés car ceux-ci n’auraient plus à craindre que, pour une raison ou une autre, les autorités politiques exercent des pressions sur la politique monétaire et créent de l’inflation. Cette crédibilité des banques centrales déclencherait une véritable prophétie où la stabilité des prix permettrait aux investisseurs financiers de mieux anticiper les développements futurs des prix et, par-là, d’allouer les capitaux aux autres acteurs économiques de la manière la plus efficiente possible. Le fonctionnement fluide des marchés suffirait alors à atteindre une croissance soutenable et le plein-emploi.
En quoi peut-on dire que la BCE constitue un prolongement de la banque centrale allemande ? Quelles sont les critiques que l’on peut adresser à ce modèle dans le cadre de l’Union européenne ?
La BCE a été créée suivant cette logique et le modèle de la Bundesbank la banque centrale allemande, qui était alors la banque centrale la plus indépendante et la plus puissante (1) de l’époque. La BCE dispose du niveau d’indépendance le plus élevé au monde (2) et a comme seul objectif prioritaire d’assurer la stabilité des prix pour atteindre une cible d’inflation de 2% par an. La reprise des caractéristiques de la Bundesbank était une condition sine qua non à la participation de l’Allemagne à la création de la zone euro parce que la culture de la stabilité des prix était une composante essentielle de sa renaissance économique après la seconde guerre mondiale. Ironiquement, cette réussite était autant due au haut degré d’indépendance de la Bundesbank qu’à la force des syndicats d’employés allemands, comme IG Metal. En effet, syndicats et banquiers centraux négociaient de manière permanente afin d’atteindre un compromis entre niveau des salaires et hausse des prix, tandis que le gouvernement allemand pouvait profiter de la création du marché commun pour exporter davantage. Le transfert du modèle de la Bundesbank au niveau européen comportait alors plusieurs risques.
En l’absence d’une structure syndicale forte et d’un gouvernement unifié, ne risquait-on pas de créer un monstre dont le pouvoir et les prérogatives risquaient fort de dépasser le seul mandat de stabilité des prix qui lui avaient été confiés ?
En fait, les premières années de la zone euro (1999-2007) ont exposé certains de ces risques car la BCE se faisait très intrusive sur des questions bien éloignées de ses compétences monétaires. Ainsi, chaque discours d’un président de la BCE se finissait par un appel à mettre en œuvre l’arlésienne des réformes structurelles (réformes des régimes de retraites, flexibilisation du marché du travail) et à serrer les vis budgétaires. À l’inverse, quand les gouvernements se prononçaient sur la politique monétaire, jugée trop stricte ou trop laxiste, les banquiers centraux montaient très rapidement au créneau pour protéger leur indépendance. Avant la crise, ce dialogue entre gouvernements et banquiers centraux n’était que spectacle et déclarations stratégiques sans réelle portée car aucun de ces protagonistes n’avait de réel pouvoir sur l’autre.
Pourtant il semble que la crise ait fait passer ces paroles au statut de véritables incursions de la BCE dans la politique européenne ?
Avant la crise, les banquiers centraux aimaient se voir comme des parfaits technocrates : dotés de modèles de calculs sophistiqués et d’une connaissance arcanique des marchés, ils manipulaient l’économie à distance en effectuant des opérations ponctuelles, dites d’open-market, avec les opérateurs financiers (3). Les banquiers centraux pouvaient ainsi justifier leur indépendance par rapport au pouvoir politique en soulignant que leurs opérations n’étaient que des réglages fins des activités économiques, qui devaient ainsi être laissées aux mains des experts.
Le dérèglement des mécaniques financières provoqué par la crise des subprimes a poussé les banquiers centraux à intervenir directement sur les marchés de manière plus massive et plus ou moins improvisée. Les banques centrales ont directement secouru les banques les plus fragiles, facilité l’obtention de liquidité pour tous les acteurs financiers et ont aussi directement acheté des titres financiers sur les marchés. Sans ces interventions, les monstres financiers que sont BNP Paribas, Deutsche Bank ou AIG n’auraient pas survécu (4). Comme le montre le graphique ci-dessous, ces interventions ont complètement transformé la place des banques centrales dans l’économie. Discrètes hier, elles sont aujourd’hui omnipotentes.
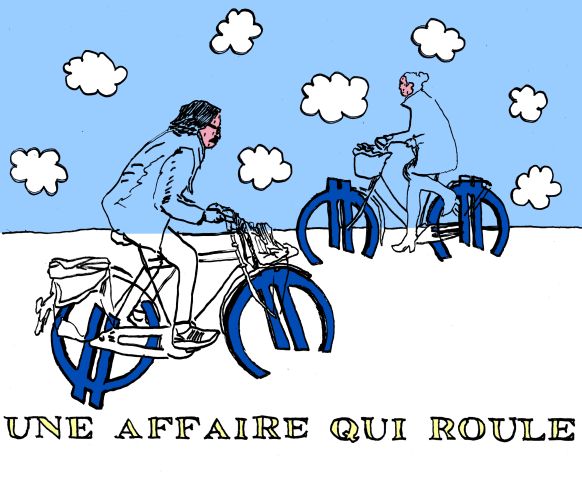
Quelles sont les conséquences politiques et humaines de ce changement de rôle ?
On peut distinguer deux conséquences politiques principales du changement de rôle des banques centrales : l’accroissement de leur pouvoir d’une part, et des effets distributifs de leurs interventions d’autre part.
D’abord, en Europe, la division des acteurs politiques a laissé les coudées franches à la BCE pour imposer son agenda de réformes néolibérales aux pays en difficulté financière. Ainsi, les banquiers centraux ont imposé un jeu funèbre du chat et de la souris avec le gouvernement grec en particulier, mais aussi irlandais, chypriote, espagnol, italien et portugais. En échange de leurs interventions sur les marchés pour stabiliser les dettes des États ou leurs banques en difficulté, les dirigeants de la BCE ont imposé une condition : la mise en œuvre des réformes néolibérales réclamées depuis 10 ans qui devaient permettre de regagner la confiance des marchés et relancer la croissance.
La participation des banquiers centraux aux groupes d’experts de la Troïka, incluant aussi la Commission et du FMI, permettait la surveillance directe de cette mise en œuvre. Quand les banquiers centraux, en accord ou non avec les autres pays européens, estimaient que les réformes n’étaient pas suffisantes, ils menaçaient de stopper leurs aides, à l’image des pouvoirs centraux dans les anciens empires coloniaux. Les menaces ne sont d’ailleurs pas toutes restées lettres mortes : la fermeture des banques grecques et la limite des retraits à l’été 2015 n’étaient qu’une conséquence directe des pressions exercées par la BCE. La démission forcée de Silvio Berlusconi, les plans d’austérité entraînant la fermeture de la moitié des hôpitaux grecs, la vente de visas portugais bradés à des criminels chinois et l’émigration massive des jeunes irlandais à l’étranger sont autant d’événements liés aux politiques d’austérité imposées, entre autres, par la BCE. Enfin, la BCE a joué un rôle central dans la gestion de la dette grecque. En mars 2010, le FMI insiste sur le fait que la Grèce ne pourra pas rembourser toute sa dette sans provoquer une catastrophe sociale et humanitaire. Pourtant, la BCE refuse toute annulation d’une partie de la dette car ceci aurait provoqué la chute des institutions bancaires qui la détenaient (principalement BNP Paribas et Deutsche Bank). Alors que les dirigeants européens s’entendaient au printemps 2011 sur un plan d’annulation d’une partie des dettes de tous les pays européens en difficulté, la BCE menace la stabilité économique de ces pays en déclarant qu’elle n’accepterait plus leurs titres de dette dans ses opérations de refinancement (6). Au final, la BCE a insisté sur le sacrifice des populations des pays du Sud pour sauver les banques françaises et allemandes et regagner la confiance des investisseurs.
Ensuite, au-delà de l’expression brute de ces rapports de force, la réponse de la BCE à la crise a aussi des conséquences distributives marquées, c’est-à-dire qu’elle a favorisé certains groupes économiques et sociaux au détriment d’autres. Ainsi, le seul effet visible de son programme de rachats d’actifs (Quantitative Easing) sur les marchés dont le montant total représente 10% du PIB de la zone euro, a été d’augmenter artificiellement le prix des actifs financiers. Comme les ménages qui possédaient déjà ces actifs appartiennent aux groupes sociaux les mieux lotis, la BCE a renforcé les inégalités économiques, raciales et de genre (les minorités visibles et les femmes possédant moins d’actifs financiers que les vieux hommes blancs âgés). Par ailleurs, les offres de liquidités massives aux banques (qui pèsent aussi 10% du PIB) n’ont pas « ruisselé » jusqu’à l’économie réelle mais ont été capturées par les opérateurs financiers qui les ont utilisées pour faire des opérations de carry trade (7) peu risquées mais très lucratives. Enfin, en addition de ces mesures, la BCE a commencé à racheter depuis l’été dernier les obligations des entreprises privées cotées en bourse. Parmi celles-ci, on trouve des entreprises modèles vis-à-vis du code du travail (Ryan air), des fleurons de l’agriculture bio (Danone, Nestlé, Unilever), des fabricants de voiture irréprochables (Volkswagen) et même un marchand d’armes (Thalès).
L’asymétrie entre la conditionnalité stricte des aides envers les États et les saignées d’austérité imposées à leur population contraste donc fortement avec la largesse des aides accordées aux acteurs financiers. Comment l’expliquer ?
Si l’indépendance de la BCE envers les autorités politiques a été très observée, l’autre facette de son indépendance, celle envers les acteurs financiers a attiré moins d’attention. La faiblesse de l’indépendance de la BCE envers la finance peut s’expliquer sociologiquement, par les phénomènes de porte tournante tels que Mario Draghi, ancien banquier de Goldman Sachs et aujourd’hui président de la BCE et Lorenzo Bini Smaghi, ancien membre du directoire de la BCE et aujourd’hui président de la Société Générale. On peut aussi observer que l’action de la BCE est contrainte par la fragilité continue du système bancaire européen : si les banquiers centraux n’imposent pas de conditionnalité stricte aux banques, c’est aussi parce qu’ils redoutent leur effondrement. La dernière explication est davantage stratégique : on a vu que la montée en puissance des idées de marché a consacré le modèle de la banque centrale indépendante. Remettre en cause l’efficience et la centralité des marchés risquerait donc de mettre en lumière des failles dans le soubassement théorique justifiant l’indépendance des banques centrales.
Pourquoi les États se refusent à réformer la BCE alors qu’elle participe du marasme économique ambiant ? Quelles seraient les possibilités de réformes pour que la BCE soit au service des peuples et non des intérêts économiques et financiers ?
Même si elles sont indépendantes, les autorités politiques ont trois moyens de limiter les pouvoirs des banques centrales : les juges peuvent annuler leurs décisions, les gouvernements peuvent changer les traités et nommer d’autres banquiers centraux. Pourtant, depuis 2007, il n’y a pas eu de changement fondamental dans la relation entre les banquiers centraux et les autorités politiques, malgré l’apparition de voix de plus en plus critiques sur l’action de la BCE, notamment au sein du parti d’Angela Merkel. L’explication la plus probante à cette étonnante stabilité est sans doute liée encore une fois à la fragilité du système bancaire. En moyenne, les banques de chaque pays de la zone euro pèsent 350% du PIB de leur pays et la stabilité de chaque système bancaire dépend de la stabilité du système voisin. Elles sont donc trop grosses pour pouvoir être recapitalisées et trop connectées pour être mises en faillite.
Dans ces conditions, l’action de la BCE est une aubaine inespérée pour les gouvernements qui se réjouissent de cette aide discrète accordée aux banques et au refinancement de leur dette malgré l’ensemble des conséquences négatives engendrées depuis l’avènement de cette nouvelle ère des banques centrales. Autrement dit, tels des Dr Frankenstein des temps modernes, les gouvernements européens ont créé des colosses financiers aux pieds d’argiles (les banques universelles) et ils doivent s’en remettre à une autre de leur créature (la BCE) pour éviter leur effondrement. L’analyse de ce nouvel âge des banques centrales est donc un bon point d’observation du rapport de force continuel entre finance et démocratie, et le tableau peint devant nos yeux fait froid dans le dos.
Propos recueillis par Omär
- La mobilité des capitaux conjuguée à l’attractivité économique de l’Allemagne pour les investisseurs forçait de fait les autres banques centrales à s’aligner sur les politiques de la Bundesbank.
- L’absence de pouvoirs du Parlement Européen sur la BCE et la quasi impossibilité de réviser les traités européens en sont les deux explications principales.
- La nature de ces opérations ressemble beaucoup aux activités du préteur sur gages ou du gérant du mont de piété : les banques centrales prêtent un montant de liquidités aux acteurs financiers pour une ou deux semaines à un certain taux d’intérêt contre la mise en pension des actifs financiers possédés par les banques. Quand le prêt arrivait à son terme, l’échange se faisait en sens inverse et les actifs gardés en garanties étaient retournés contre le montant prêté.
- En 2008, le modèle commercial de ces grandes banques consistait à se financer principalement auprès des autres acteurs financiers (plutôt qu’avec les dépôts des épargnant.es) et à investir sur des catégories d’actifs risqués et lucratifs (comme les subprimes ou la dette grecque). Du fait de la crise, les acteurs financiers n’osaient plus se prêter entre eux et la valeur des actifs risqués avait fortement diminué. Les banques centrales ont permis un financement à taux quasi nul avec leurs offres massives de liquidité et, par leurs achats, ont stabilisé la valeur des actifs risqués
- La balance comptable des banques centrales représente l’ensemble de leurs passifs (prêts accordés) et de leurs actifs (titres financiers détenus).
- Quand la banque centrale n’accepte plus certains titres de dette, ceux-ci perdent de leur valeur. Les États auraient alors dû emprunter à un taux plus élevé et leur système bancaire (qui est le plus exposé à la dette nationale) aurait dû être recapitalisé.
- Prenons l’exemple suivant pour illustrer les opérations de carry-trade. Une banque A emprunte 100 euros à 1% à la banque centrale sur trois ans pour acheter 100 euros de dette souveraine à 5% sur trois ans. La banque empoche la plus-value de cette opération très peu risquée.

